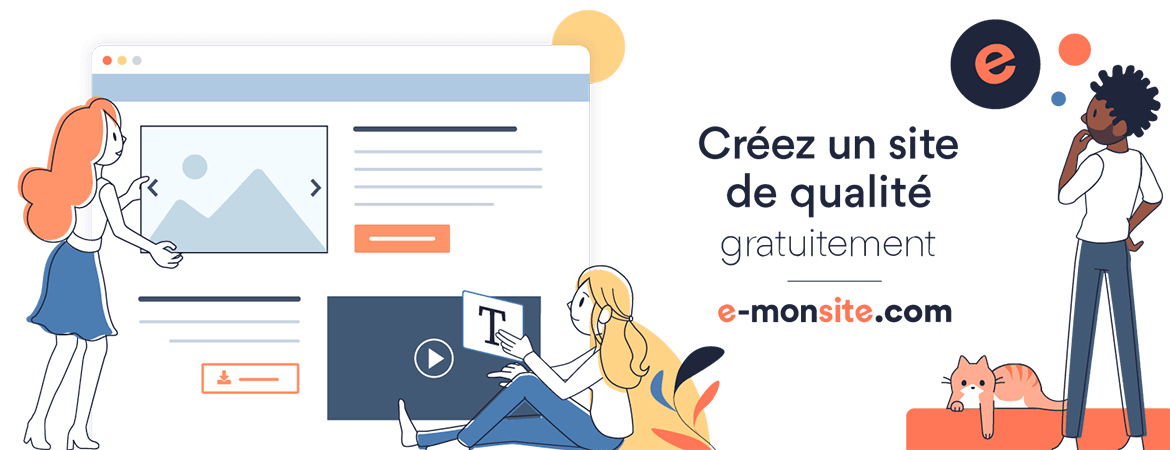COVID GRIPPE
-
L'éthique de la papaye - Nouvelle d'actualité ( parue sur Media part et Actualitté)
- Le 04/04/2020
- Dans Réflexion critique
L’éthique de la papaye.
Nouvelle d’actualitéJe ne sais à quoi peut servir un auteur par temps de guerre. Mais ce dont je suis certain, c’est qu’il peut, par exemple, se sentir légitime à « l’ouvrir », si dans son parcours, un « quelque chose de ses rencontres », l’expérience « d’un ou une autre » dans un « ailleurs et autrement », peuvent être versées à la compréhension, à la progression commune des choses. Il y a quelques jours, dans une réflexion sur « l’Après », je posais des questions, parce que je ne savais rien faire d’autre qu’interroger le réel. Aujourd’hui, je raconte une des réalités qui servit, bien qu’elle ne soit pas relatée dans le roman, à l’écriture de Salone. La métaphore et le symbole sont un des axes forts de la fiction. Ils nous permettent de sortir du cadre et d’observer notre réalité sous un autre angle. Cette histoire est donc, comme on dit, « fondée sur des faits réels ». Elle peut apporter un éclairage parmi d’autres, au tragique débat qui fracture, en France, plus que jamais le milieu médical et le milieu politique ; et qui, en réalité, s’avère un conflit éthique. (Le Quotidien du médecin du 02/04/20) Je l’ai écrite parce qu’elle illustre les raisons d’agir des hommes et femmes de médecine. Elle n'expose pas d'« avoir raison » ou d' « avoir tort » dans cette affaire, seulement les contraintes d'un choix éthique. N'est ce pas là le principal ?
Le contexte : Sierra Leone 1999. Le pays a été ravagé par une guerre importée du Libéria. Elle ne fut ni civile ni tribale, elle fut autre : complexe. On voulut croire que Salone racontait une histoire africaine ou une histoire de guerre, il fallait classer l’objet. Mais il n’en était rien. Salone raconte l’histoire du délitement d’une société, celle d’une nation structurée et d’une élite dépassée par les évènements.
À cette époque, les rebelles envahirent Freetown, puis en furent chassés. On coupa des mains par milliers. La population fut terrorisée. Sur place, les ONG répartissaient comme elles pouvaient leurs ressources, dans des hôpitaux de campagne ou des hôtels désaffectés. L’un d’entre eux fut un temps transformé en centre de réhabilitation pour enfants-soldats. Bien sûr, on y soigna aussi des villageois en fuite, des femmes violées au fil des routes, des enfants mutilés… On soigna. Ce fut-là, une première injonction : infirmiers, médecins, aides-soignants se plièrent à cet impératif : soigner, soigner, soigner. Une des urgences les plus courantes consistait à intervenir sur des plaies ulcéreuses et nécrosées. Certains arrivaient avec sur leur jambe des vers qui mangeaient la chair de la blessure, parce que c’était aussi un soin. L’autorité médicale de chaque district, en Sierra Leone, était représentée par un « Dispenser ».
L’histoire
À quelques miles de Freetown, un homme de 28 ans occupait ce poste ; nous l’appellerons Julius. Il n’était pas médecin, mais son grade de Dispenser nécessitait de suivre un sérieux cursus d'études médicales en Angleterre. Dans sa corporation, certains parmi les plus âgés, avaient laissé s’émousser l’arrogance de leur jeunesse : soigner en brousse érode les plus solides certitudes académiques. Lui, Julius, revenu d’Angleterre un an plus tôt, acceptait l’enfer qui régnait sur son pays comme une épreuve, la menant avec toute la rectitude et le professionnalisme qu’il savait mobiliser. Il avait été formé pour ça. Il connaissait les protocoles et les appliquait. Courageux, dévoué, apprécié, il menait sa barque.
Un jour, les antibiotiques, les pansements, les désinfectants vinrent à se raréfier puis à manquer. On en recevait encore, mais de manière sporadique. Alors on espaça les soins. Les surinfections se multiplièrent. On mourut. Plus. Beaucoup plus. Julius se démenait jour et nuit pour répartir la charge de travail de ses soignants ; il affrontait les barrages militaires pour transporter vingt pauvres pansements ici, là trente comprimés d’antibiotiques ; il risquait à chaque fois sa vie et s’épuisait. A cette époque, en Sierra Leone, on se déplaçait comme on pouvait, l’essence était rare, les embuscades probables, les abus de militaires eux-mêmes étaient à craindre.
Le médecin d’une ONG anglaise — nous l’appellerons Mike Briddle —, en route vers Freetown pour rejoindre le compoud de la Croix rouge, fut refoulé à un barrage militaire, fit demi-tour et vint demander à être hébergé dans l’ancien hôtel dont Julius avait fait son quartier général. On était en milieu d’après-midi, en mai. Les premiers signes de la saison des pluies apparaissaient, de lourdes nuées rampaient sur les collines et la mer. Julius reçut l’homme entre deux soins, devant la porte d’entrée d’un vaste bungalow.
— Mike Briddle, c’est ça ? LE Mike Briddle ?
Julius observait à la dérobée la dégaine du vieux bonhomme ; il acquiesçait tranquillement en hochant de la tête.
— On vient de me dire que vous demandez à dormir ici.
— Juste cette nuit. Demain ce sera une autre équipe au barrage, j’essaierai de passer à nouveau.
Julius se donna le temps de réfléchir en s’essuyant les mains sur un chiffon taché de longues trainées brunes. « C’était ça le vieux Briddle ? pensait-il, bah ! Après tout, ça me fera de la compagnie ce soir, on pourra discuter. Il doit en avoir des choses à raconter ce gars-là ».
— D’accord, je vous filerai le hamac sur la terrasse. C’est tout ce que j’ai.
— Ça ira très bien, je vous remercie.
— Je vous laisse y aller, j’ai du travail, répondit Julius en s’apprêtant à disparaitre à l’intérieur.
— Attendez !
— Oui ?
— Un coup de main ? J’ai du temps.
Julius hésita : de l’aide pensait-il, bien sûr oui. Mais laquelle ? Briddle ou pas, ce gars aux cheveux gras, campé là dans sa tenue de brousse, semblait sorti tout droit d’un mauvais film d’aventures ; de plus, les médecins anglais, ils les avaient fréquentés ! Eux et leur condescendance pour le p’tit gars qui débarque de l’ex-colonie pour se former.
— D’accord, mais je vous avertis, ce lieu est sous ma responsabilité.
— Pas de problème, bien sûr…
Il ne fallut à Mike que quelques secondes pour comprendre : l’odeur d’abord, puis les pansements trop sales, les visages fiévreux ; il y avait là dans la pénombre, une dizaine d’hommes assez âgés, allongés sur des bouts de matelas ou des tas de tissus mal rassemblés.
Julius murmura :
— On fait avec les moyens du bord. Il ne reste presque plus rien, vous comprenez ?
— Oui, oui bien sûr…
— Voilà, celui-là, dit-il en désignant l’homme allongé près de la porte, le pansement sur sa cuisse est à refaire ! Les produits et les compresses sont là-bas sur la table. Faites attention ! Il en reste très peu.
— Elle date d’au moins trois jours, commenta Mike qui s’était approché du malade et inspectait la compresse sale.
— C’est ce que je vous dis ! On n’a pas le choix. Plus rien n’arrive depuis une semaine. Bon ! je vous laisse, je passe dans le bungalow à côté. Retrouvez-moi là-bas quand vous aurez terminé. Merci !
Ils travaillèrent en fait chacun de leur côté, par souci d’efficacité, puis se rejoignirent à la nuit tombée, sur la terrasse du bungalow qu’occupait Julius, un peu à l’écart des autres bâtiments. Peu à manger : un reste de corned-beef, des galettes de manioc, une bière chaude, tout ça réuni sous la lueur d’une bougie fixée au milieu d’un cul-de-bouteille en plastique. Ils parlèrent de la guerre et du passé de Mike. Ça se faisait par bribes de souvenirs, à coups d’évocations douloureuses, parfois drôles, comme celles de ce gars, nu comme un vers, qui au petit matin la semaine passée, du côté de Bo, avait surgi du bush en criant qu’une bande de kamajors[1] lui avait tout pris. Bien sûr il n’aurait pas fallu en rire, mais c’était venu comme ça, et c’était bon de lâcher un peu de joie dans l’air.
« Bon, faut que j’aille dormir, maintenant », dit Julius en ramassant la boite de conserve et les fourchettes.
— Julius, juste une minute ! Je voudrais vous dire quelque chose.
L’autre hésita ; et sur un ton las :
— Quoi ? — puis il se rassit — allez-y, je vous écoute. Pas trop long s’il vous plait, ajouta-t-il en soupirant, comme déjà affecté d’avoir à argumenter, s’expliquer, peut-être se justifier.
Mike se racla la gorge. Il avait plusieurs fois affronté ce genre de situation : guerre des Mau Mau au Kenya, celle « du bush » en Rhodésie et d’autres, d’ex-colonie en ex-colonie ; ses quarante années de médecine en milieu tropical lui avaient asséché l’âme ; mais elles avaient renforcé aussi sa maîtrise du métier, l’avaient étayé de ce genre de pragmatisme rude, sans compromis, qui s’impose quand tout vient à manquer. Mike Briddle était connu de toutes les ONG. Pas un secrétaire, à Londres, n’oubliait avant de proposer une mission à quelqu’un de plus jeune, de s’enquérir de la dispo « du vieux ». Briddle était le Joker des missions difficiles. On disait de lui qu’il pouvait même, sans antibiotiques, sauver une jambe de la gangrène.
Julius attendait. Il avait entendu parler de tout ça. Bien sûr, c’était des légendes. Il avait vu Briddle travailler tout l’après-midi : concentré, calme, il avait fait le job ! Bien. Comme tout le monde. Et ça n’avait rien de miraculeux.
Julius, je pars demain, alors ce que je vais vous dire, vous en ferez ce que vous voudrez. J’ai observé tous ces gars, ces femmes, leurs gamins… Vu l’état de leurs blessures, et le peu de produits qui restent, vous n’allez pas en sauver deux sur dix.
— Vous croyez que je l’ignore ?
— Attendez ! Laissez-moi vous expliquer, j’ai connu ce genre de situation. Et vous avez une chance de vous en sortir. C’est une méthode que j’ai utilisée, elle fonctionne, mais ça n’a rien d’officiel…
— C’est-à-dire ?
— Derrière vous ! Mike désignait un plateau où étaient déposés trois gros fruits verts un peu oblongs. Julius se retourna brièvement.
— Quoi ? Ces papayes vous voulez dire ? Bah ! Mais qu’est-ce vous racontez !
— Julius, je vous assure que ça marche. Il faut appliquer le cataplasme avec la bonne méthode, mais ça marche !
— Mais ça va pas ! Même les Juju men ne m'ont jamais parlé de ça ! Bah ! ous kind bush mérécin nar this ! C’est quoi cette médecine de brousse ! (2)
Et il se leva brusquement pour disparaitre dans la cuisine où il s’affaira longuement à une vaisselle très sommaire. Lorsqu’il revint, Mike rangeait un stylo dans sa poche de chemisette et tendait un papier : « Tenez, je vous ai indiqué la procédure. Vous ferez ce que vous voulez. Moi je vous dis que ce fruit, surtout quand il est très mûr, libère une substance active qui nettoie les chairs infectées. Il faut compter trois à quatre jours. Vous ne disposez que d’une seule chance et c’est demain, parce que j’ai compté à peu près le nombre de compresses qui restent. Soit vous les économisez comme vous faites, c’est le bon protocole, et la plupart de ces gens vont mourir dans les dix jours. Soit vous épuisez le stock dont vous disposez en une seule fois, pour ce cataplasme à la papaye, sous cellophane, scotch, tout ce que vous trouverez d’étanche pour le protéger et qu’il tienne, et dans quatre jours tout est fini, vous en aurez sauvé les trois quarts ! Les autres, c’est qu’ils sont déjà trop atteints par l’infection. Voilà, Julius…
Julius accepta le papier en marmonnant un bref « Merci on verra », puis rejoignit sa chambre. Mike s’installa dans le hamac, rabattit la moustiquaire et s’endormit rapidement. Une heure plus tard, une brise descendit des monts et imprima à la toile un léger mouvement de bascule. Réveillé, Mike Briddle regardait le ciel. C’était sans doute sa dernière mission ; et il se demandait s’il aurait assez de place pour fixer son propre hamac sur la terrasse du deux-pièces à New Heaven. Un bruit attira son attention, il tourna la tête et aperçut un homme qui franchissait les deux marches du perron ; Julius s’avançait vers lui. Ils se mirent à parler à voix basse et Mike Briddle put saisir une bribe de phrase portée par le vent : « Bo duya you go manage find some popo them...rape -rape one » : débrouille-toi pour trouver rapidement plein de papayes bien mûres, et vite !
Laurent LD Bonnet – mars 2020.
www.laurentbonnet.eu[1] Bandes de chasseurs réorganisés en milices.
2 Langue krio
Conflit éthique : Le Quotidien du médecin 02/04/20
-
Grippe et Paix 1969-2020 - Réflexions sur l'après guerre.
- Le 22/03/2020
- Dans Réflexion critique
Cette photo…
Cette république avait onze ans, New York remplaçait Paris,
Déjà sous cette Cinquième, naissaient de possibles marquis,
Et de futurs présidents, chez qui, par maint endroit,
Le front de monarque briserait le masque étroit.[1]Tolstoï, Hugo, pairs et génies des lettres, s’il vous plait, ne m’en voulez pas de ces emprunts détournés, je n’ai su me retenir.
Cette photo …
68 s’achevait. Nous, gamins, avions failli être gavroches. De Gaulle, qui n’avait guère besoin d’anaphores pour s’affirmer chef de guerre, acceptait son déclin. La guerre, de vingt-cinq ans notre ainée, trainait partout en famille ; on entendait au moment de rompre le pain : « Encore un que les boches n’auront pas ». Les morts rôdaient encore. Nous le savions. Mais la paix grandissait, déjà drapée de sa normalité.
Puis venant d’Asie, passée par les USA, précisément l’hiver 69 où fut prise cette photo, une grippe s’installa en France. Plus de 31000 morts en deux mois ! Or je me souviens des barricades, des discussions enfiévrées, des livres et des photos sur Buchenwald, de films de toutes sortes, et d’Apollo, de la lune et des étoiles, du Vietnam, des bombes là-bas et du napalm, de deux mots répétés sans cesse à la radio : « marché commun » et j’ai mis si longtemps à comprendre que sous la parure d’Europe, c’était bien sûr encore eux qui menaient la danse… Oui je me souviens de tout cela et de bien d’autres choses, avec lesquelles, nous, gamins, nous meublions notre mémoire. Mais des 31226 morts[2] en France et plus d’1 Million dans le monde, dus à cette « grippe de Hong-Kong » : RIEN ! Aucune trace, aucun souvenir. Elle est passée ainsi la grande faucheuse, sans remuer plus que ça l’opinion, les pouvoirs publics, la presse… qu’on ne qualifiait pas encore de média. Libération raconte :
« Que l'«épidémie» frappe urbi et orbi l'humble et le puissant, voilà d'ailleurs qui déchaîne l'humour plus que l'émoi. Le 31 décembre 1969, pour le réveillon, le Monde offre un billet badin décrivant, en direct de Londres, le délicieux chaos qui grippe la perfide Albion (plus durement touchée que la France) : les hôpitaux de la capitale devenus le «dernier salon où l'on cause» puisqu'on y rencontre artistes et célébrités politiques, celui de Birmingham «qui embauche n'importe qui» afin de faire face à la défection de «500 infirmières», les queues devant les pharmacies pour les livraisons d'aspirine, les pannes d'électricité faute de techniciens, les lignes de métro interrompues faute de conducteurs... En janvier, Paris Match n'envoie pas ses paparazzi dans les urgences saturées, mais dans l'alcôve Louis XVI où s'alanguit Marina Vlady : «Non, titre l'hebdo, Marina n'a pas la grippe de Hongkong, elle tourne son nouveau film.» La grippe, dont nul ne signale les morts, est alors moins qu'un fait divers. C'est un «marronnier d'hiver», écrit France-Soir... ( Par Corinne Bensimon — 7 décembre 2005) »[3]
Que dit de nous cette amnésie ?
Elle interroge notre rapport à la mort bien sûr. Soixante années de paix, de progrès scientifiques l’ont totalement et profondément modifié.
Elle interroge l’aune dont nous usons pour jauger de la gravité. Et sur cette photo, l’insouciance se lit dans beaucoup de regards. Je ne suis pas certain que la même puisse être prise aujourd’hui, à supposer que l’on puisse encore capter les regards. On y lirait sans doute, l'écho démultiplié des anxiétés en réseau, l'accélération fébrile des injonctions...
Elle questionne la dépossession progressive du pouvoir citoyen que consacra l’avènement de cette cinquième république ; et que nous, gamins de cette photo, allions confirmer huit ans plus tard en accédant à notre droit de vote, mais sans réfléchir plus que cela, tant nous semblerait confortable l’idée qu’on ait pu concevoir pour un rôle citoyen, une telle aubaine : pensez-vous ! Quelques jours de travail par an, parfois aucun, et des milliers d’autres disponibles pour jouir, travailler et capitaliser sans entrave : « On s’occupe de tout, citoyens, revenez dans sept ans ! »
Le réveil est glacial.
Elle percute de plein fouet nos certitudes : l’Etat Français tel qu’affadi par un demi-siècle — moins quelques années des lumières — d’assujettissement grandissant aux principes marchands, est encore beaucoup plus faible que « nous » (c’est-à-dire celles et ceux qui déjà ne rêvaient plus) l’avions estimé.
Cette photo…
Elle m’interroge : 25 ans de paix derrière elle et 40 autres à la suite … Des dizaines d’élections, rarement je me suis abstenu. À quoi bon ? Puisqu’au bout du compte — car il s’agit bien de cela : un compte dans le conte, un compte que nous avons à rendre à nos consciences. Et que les pitres incompétents — ceux d’avant et d’aujourd’hui que « nous », votants et abstentionnistes confondus dans une collusion perverse, mais réelle, avons tous portés au pouvoir —, auront à rendre demain, pour avoir fait d’Excel leur Dieu, et de ses formules une alchimie qui aujourd’hui nous asservit, pendant que « nous », les jouisseurs, la vénérions pour qu’elle fasse de nous des enrichis.
Cette photo oui : douze ans après elle, mon vote et ceux d’autres dans cette salle de classe, porteront la gauche au pouvoir. Un des gamins, là, fils d’ouvrier, est devenu maire d’une grosse ville de province. Nous étions amis. Et puis sur cette photo aussi, certains voteront à droite. Et je me demande : une autre histoire politique aurait-elle mené au même tragique fiasco d’aujourd’hui ? J’ai envie de dire oui, de ne plus croire à l’idée que le pouvoir est encore — un peu quand même — entre les mains du citoyen. Mais pourquoi le serait-il ? Puisque nous en avons abandonné la maîtrise en nous laissant refourguer cette foutue et confortable idée de délégation sans contrôle !
Et donc sur cette photo encore, combien parmi ceux qui vivront en 2022 (les statistiques proposent 80% en ce temps dit de paix) feront encore semblant de croire, de participer, par leur ignorance, leur déni ou leur adhésion, à la soupe messianique qui nous sera servie ?
En réalité, cette photo ne me donne plus qu’une envie : lever la main et poser une question à l’instituteur debout à côté du photographe. De lui je me souviens !
Deux choses précisément : d’abord il montait à la corde ; celle-ci, accrochée au centre de la trémie d’un vaste escalier, s’ouvrait jusqu’au toit, sept mètres au bas mot. Et cet homme, au début de chaque cours de sport, commençait par s’asseoir à terre et montait à mains nues, jambes à l’équerre, jusqu’au sommet. Rien à voir ? Pas si simple. Car pour nous, gamins, c’était un exploit. Certes physique, mais il nous menait à une forme de respect. Et sa parole, en salle, devenait d’or ou d’airain, selon nos besoins. Alors j’en viens au second souvenir : cet homme qui sans doute avait connu la guerre, l’avait faite, l’avait perdue puis l’avait gagnée (j’appris plus tard son action en Résistance), nous assénait une phrase à chaque leçon d’histoire, toujours la même, et je ne suis pas certain de l’avoir si bien comprise à l’époque. Pourtant elle m’est restée, et ce dont je suis certain à présent c’est de l’avoir intimement et définitivement acceptée, ce 16 mars 2020, quand Emmanuel le petit, se fendit de son anaphore guerrière pitoyablement nécessaire. Parce que l’instituteur nous répétait, et je le cite : « Quand on fait la guerre, c’est qu’on a perdu la paix. » D’autres l’ont dit, ailleurs et mieux sans doute, mais lui, c’est dans la tête des gamins de cette photo qu’il inscrivit cette phrase.
Elle m’amène aujourd’hui à une conclusion : cette paix, celles et ceux que nous avons portés au pouvoir depuis un demi-siècle, l’ont perdue. Nous l’avons perdue avec eux. Cela s’analyse, se décrypte, s’explique. Et l’évidence qui s’impose à nous, sauf déni et aveuglement, c’est qu’un monde fondé sur des prémices industrielles et marchandes est une impasse. Ce n’est même plus la peine d’en discuter, c’est, de fait, une, impasse !
Le seul préalable acceptable de toute future organisation, ne peut plus être que l’affirmation de la préservation des biens communs essentiels à la vie : notre air, notre eau, notre environnement. Cela doit fonder les bases d’une nouvelle constitution, un nouveau corpus de valeurs, de nouvelles lois, une nouvelle organisation politique, au sein desquels nous, et nos enfants et les enfants de nos enfants, pourront respirer. C’est là, je crois, le seul programme politique auquel on devra apporter crédit en 2022 : la refonte immédiate de notre organisation citoyenne. Reprendre le pouvoir quotidien est notre seule alternative. Tout autre programme qui s’appuiera sur un catalogue d’intention ou de promesses ne sera que soumission à un énième rhéteur, expert en manipulation des émotions[4].
Non, vraiment, le seul discours audible, le seul engagement crédible sera : « Je n’ai qu’un unique programme, l’imagination, la vôtre, pour participer à la rédaction et à la mise en œuvre d’une nouvelle constitution. Rien d’autre. Désolé. Je vous demande juste de m’élire pour que je puisse vous redonner les clés de la maison. »
Oui, je sais, j’écris des fictions, on dira que je rêve. Tout cela n’est qu’hypothèse de romancier. Restez dans la photo !
Bien, j’y retourne alors… Mais je lève la main, quarante années plus tard, et je la pose cette question : « M’sieur, M’sieur ! On a compris. On n’a plus envie de jouer. Comment on fait pour sortir du conte ? »
[1] « Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte.
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte,
Et du Premier Consul déjà par maint endroit
Le front de l’empereur brisait le masque étroit. »1728
Victor HUGO (1802-1885), Les Feuilles d’automne (1831)[2] Unité 707 de l'Inserm-Université Pierre-et-Marie-Curie, à Paris.
[3] https://www.liberation.fr/france/2005/12/07/1968-la-planete-grippee_540957
[4] Le Gorgias de Platon : Dialogue sur la rhétorique