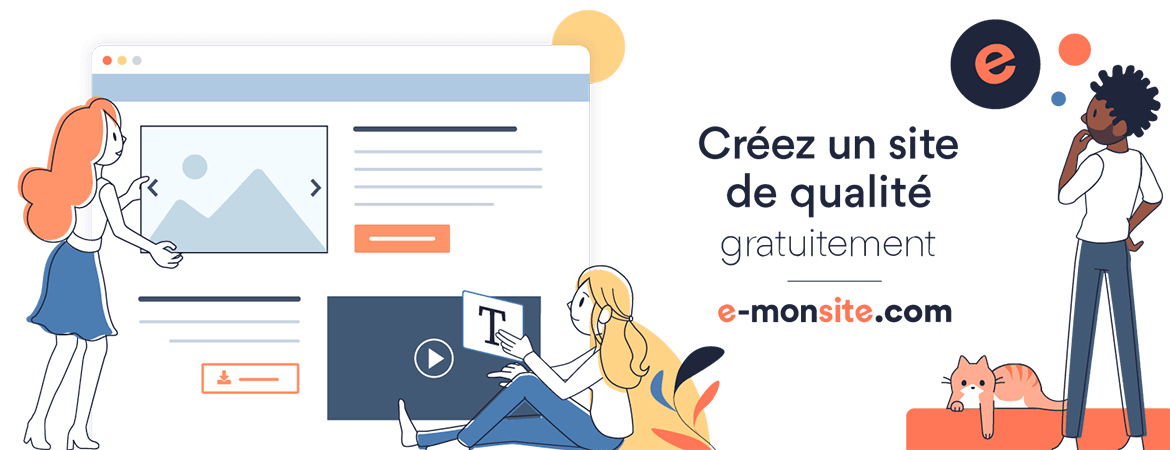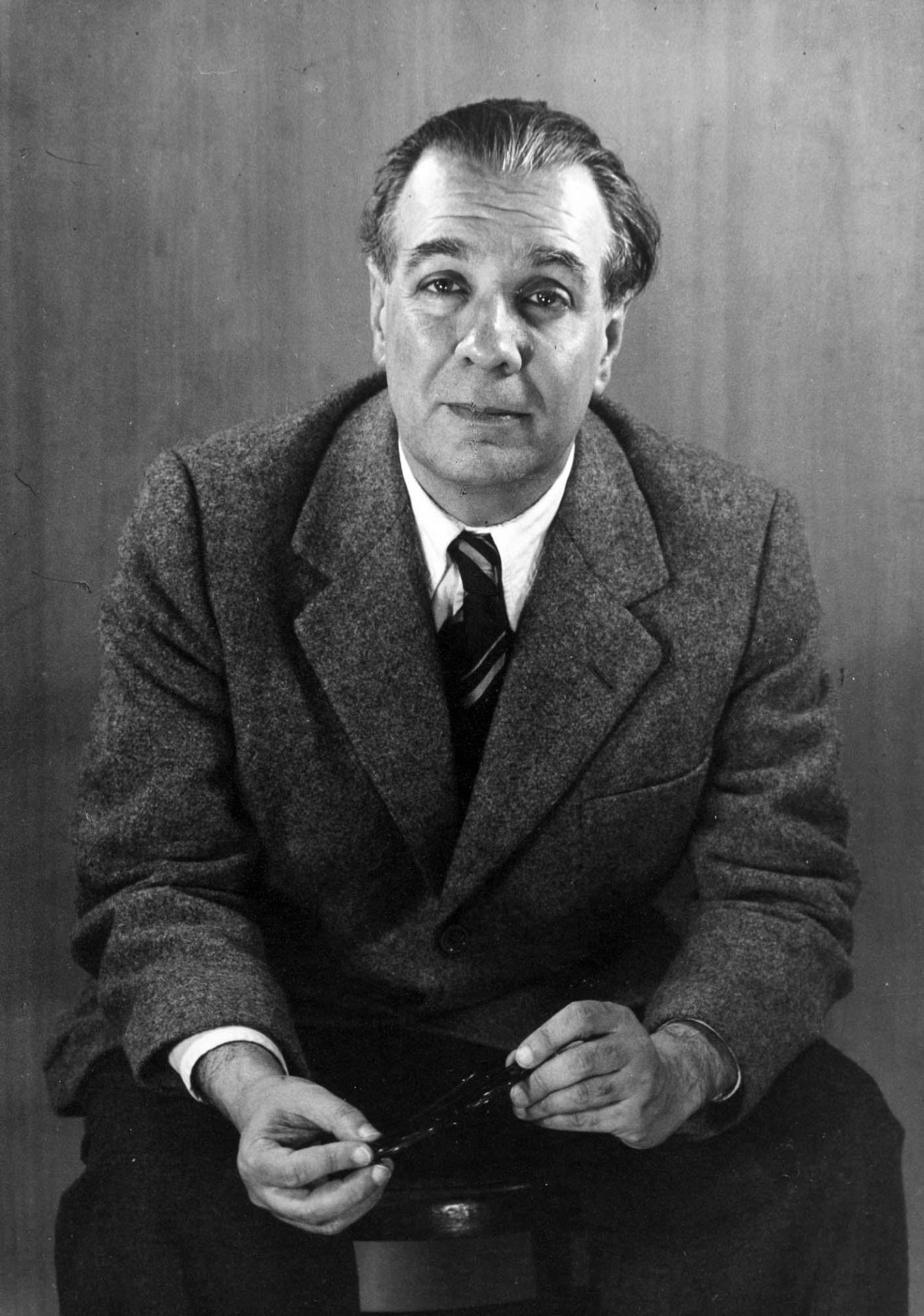Réflexion critique
-
De la consécration littéraire
- Le 19/12/2022
 En écoutant le discours de réception du Nobel de Madame Ernaux, je voulais vérifier le fondement de son manifeste exprimé dans La place (Lien en bas de page) : “Je ne me sens pas le droit de prendre le parti de l’Art, pour évoquer les êtres soumis à la nécessité.”
En écoutant le discours de réception du Nobel de Madame Ernaux, je voulais vérifier le fondement de son manifeste exprimé dans La place (Lien en bas de page) : “Je ne me sens pas le droit de prendre le parti de l’Art, pour évoquer les êtres soumis à la nécessité.”Elle expliquait ainsi l’emploi du style simplissime.
On pouvait, à ce stade, déjà lui rétorquer que si Yourcenar, Goya et Picasso avaient suivi ce principe pour sublimer leurs ressentis, nous n’aurions pas à notre disposition les œuvres universelles qu’ils nous ont léguées. Mais soit : à cet instant, l’hypothèse existait encore qu’il s’agissait d’une volonté, une affirmation, et que de la même manière que certains méconnaissants ont pu reprocher à Edward Hopper de mal maîtriser la technique picturale des personnages – alors que ses œuvres de jeunesse démontraient le contraire – nous étions ignorants d'une forme nouvelle de génie. Or dans le cas de Madame Ernaux – celle-ci n’ayant rien à montrer d'une maîtrise passée – le présent dès lors, lui offrait l’occasion d’un grandiose et savoureux pied de nez : concevoir et déclamer un discours de réception d’une hauteur stylistique qui balaie magistralement le mépris de classe dont elle a toujours affirmé vouloir se venger ; autrement dit, battre l’ennemi en usant de son arme, cette fameuse belle langue que l'on dit de droite.
Las… Ignorants et délaissés nous resterons : Madame Ernaux s’avéra incapable de se hisser a la hauteur de l’enjeu : discours plat, nombriliste, sans relief, sans vision et définitivement sans style.
Encore une chance ? Vérifier que notre objectivité n’était pas soumise à un biais quelconque… Et pour cela, comparer avec le discours d’Albert Camus qui, chose faite, hélas pour Madame Ernaux, déroule son implacable qualité.
Alors se greffe dans l’âme le goût amer d’une possible imposture. Celle d’un système de prescription qui, à force d’être assujetti au principe marchand, finit, jusqu’au plus haut degré de la pyramide, par faire du succès de masse le maître étalon à l’aune duquel se mesure la qualité créatrice.
Règne de la banalité !
Et pourquoi ne pas formuler l’hypothèse que si Musso et Levy s’étaient prénommés Guylaine et Martine, ils auraient pu briguer le Nobel ?
L LD B
-
Tétralogie de la quête : Salone , la vengeance
- Le 01/12/2022
On me demande pourquoi un auteur accepte de voir nommer son oeuvre par un éditeur, d'une manière qu'il n'a pas lui-même imaginée.
La réponse est toujours la même, celle de Borges exprimée dans cet autre article : l'auteur écrit, sans conscience du regard porté par les lectures.
Ainsi le nouveau regard éditorial, à l'occasion de mon roman le dernier Ulysse, a-t-il permis de répondre enfin à une question que m'avait posée presque systématiquement chaque passager embarquant sur Keila : — Vous écrivez dans quel genre ? — En fait, aucun ... — Oui, mais alors, que racontez-vous ? — Des histoires .... — Par exemple ? etc...Une seule fois, parce que mon passager était Maxime Drouot ( Chattam), lui versé dans un genre, et que nous discutâmes de segmentation en littérature, me permit de comprendre que, oui peut-être, j'avais écrit autre chose que des histoires.
Il fallut quelques années et 300.000 mots de plus, pour qu'un regard éditorial décide de proposer les lectures Salone, puis Dix secondes et le dernier Ulysse, comme celles d'une Tétralogie de la quête. (Vengeance - Rencontre - Création et pour le travail en cours, la Légitimité.
Affaire à suivre, donc ... Mais je dois avouer que je suis heureux de n'avoir eu aucune conscience de ce chemin entre 2009 et 2021.
Aujourd'hui, je me sens comme le navigateur d'un voyage spatial dont l'aboutissement approche : on en connait l'effort ; on sait d'où on vient ; on sait où on va, intellectuellement accompagné par l'étude des trois planètes visitées depuis le départ... Mais le souvenir de la Terre est lointain. C'est heureux, parce qu'il va falloir apprendre à vivre sans... Le retour est impossible.Voici un extrait de Salone : ( page 137) où Shaun reçoit l'écho de la pensée de Scobie ( Graham Green Le fond du problème) :

autres extraits :
-
Houellebecq , Sérotonine, Baroud Gaulois en Publicie
- Le 03/01/2022

Sérotonine : Ou comment Florent Claude Labrousse détrôna SAS
Malongo, Repsol, Coca, Mercedes, Volkswagen, Zadig et Voltaire, Iphone, Relais Châteaux, Figaro Magazine, Uber, Vanity Fair, Mercure, Novotel, SFR, BNP, Google, Carrefour City, YouTube, Nespresso, Ferrari, YouPorn, Danone, Camel, Appart City, MacDonalds, Super U, Chablis, Nissan, Firefox, Schmidt & Bzender, 4x4 Defender, Ouest-France, Skype, Smith & Wesson, Swarowsky, Phillip Morris, BFM, Leclerc, Nesquik, Gitane, Amazon…
Qu’on ne s’y trompe pas ! Ces citations de marques ne sont pas celles de l’auteur qui, jusqu’en 2013, fut le champion incontesté d’une stratégie marketing peu courue en littérature : le placement de marque.
Gérard de Villiers écrivit ainsi 200 romans qui narraient les aventures internationales, jamais françaises, de Son Altesse Sérénissime Malko Linge, noble autrichien et espion. Il en vendit près de 150 millions d’exemplaires. Littérature de gare, disait-on dans le sérail en se bouchant le nez ; tout en lorgnant ce genre de pratique.
En 2001, Marie Gobin, du magazine Lire, écrivait : " Pour l’heure, le livre sans publicité a encore de beaux jours devant lui. Car il compte plusieurs alliés de poids. Parmi ceux-ci, son lectorat qui n’apprécie pas de le voir pollué par la réclame. Et surtout la publicité elle-même, peu attirée par l’image de l’écrivain. Pas assez médiatique ! Pas assez vendeur ! Trop intellectuel ! Et si son bouquin demeure confidentiel ou s’il lance une polémique ! Et puis, avec quel produit un livre peut-il s’acoquiner ? Non, ce serait sans doute trop risqué. Ouf !…"
Las, c’était une espérance que vient d’anéantir l’histoire récente de l’édition. Soutenue en cela par une large abdication de lecteurs et critiques : qu’importe la pollution pourvu qu’on ait l’ivresse ! SAS Malko Linge, grand consommateur de Champagne Taittinger, concentré toutes les deux pages sur sa montre Seiko à quartz tout en actionnant de manière souvent sodomite sont vit turgescent (une quasi marque…), peut aller se rhabiller. Il a trouvé en guise de maître son antithèse ! Accueillons ici, dans Sérotonine, son indigne successeur : Florent Claude Labrousse, FCL.
Celui-ci, vaguement contrit par l’escalade des turpitudes sexuelles de sa maîtresse qui préfère se faire prendre par un doberman et délivrer des fellations à un bull-terrier et un boxer, se réfugie – on le comprendrait presque cet homme – dans les bras d’une impuissance, érigée, osons le mot, en principe. On passera sur les aventures sur-commentées de FCL en « glauquitude », un vaste territoire gaulois où gravitent pédophiles, révoltés suicidaires des campagnes, et amours perdues qu’on ne rêve que d’occire pour mieux résilier. En effet, pourquoi ne pas mettre en scène une déchéance banale et médicamentée, plutôt qu’un éternel héroïsme improbable ? L’un et l’autre se bousculent probablement dans nos imaginaires. L’identification est une des clefs de la fiction. Question de cible…
Sacrilège ! s’écrieront ceux qu’aveuglent encore les lumières passées de l’icône instituée, créateur de FCL. Comment peut-on placer sur la même étagère critique des styles et des inspirations de valeurs aussi différentes ? La réponse est simple : à prendre les lecteurs pour des gogos, à concevoir la littérature comme un produit avant d’être une œuvre, à user de stratégie plus que de cœur, et pour finir, à faire du placement de marques la raison principale d’exister de 345 pages, advient ce que trop d’éditeurs ignorent : les personnages formant un peuple, certains se rencontrent et se parlent. En aucun cas ils ne s’ignorent dans nos mémoires. J’en veux pour preuve cette scène qu’un ami barman m’a rapportée.
C’était un soir de janvier au bar d’un grand hôtel parisien, un de ces endroits qualifiés de branchés par ceux qui font profession de l’être. Malko Linge traitait là quelque affaire bancale et corrompue, lorsqu’il reconnut Florent Claude Labrousse qui, solitaire au bout du comptoir, s’entretenait avec un verre de whisky. Il s’approcha pour se présenter :
– Je m’appelle Linge, Malko Linge. Très heureux de vous rencontrer Monsieur Labrousse. Vraiment.
– Oh, vous ? répondit Labrousse en lui adressant un regard amusé qui pouvait aussi bien signifier une forme de surprise polie, que rien à foutre mon pote de ton bonheur de me connaître.
– J’ai très peu de temps à moi Monsieur Labrousse – Linge jeta un œil à sa montre, tourna la tête et adressa un signe à la femme qui l’attendait un peu plus loin ; elle s’éloigna – je voulais juste vous laisser ma carte. Nous devons absolument nous reparler.
Labrousse retint une moue moqueuse.
– Je ne vois pas bien Monsieur Linge. Nous n’avons rien de commun. Je respecte vos exploits. Mais je ne vois pas en quoi le spleen existentiel et nauséabond dont mon auteur m’a affublé pourrait vous intéresser.
– Certes, mon cher, mais vous n’y êtes pas ! Il ne s’agit pas précisément de nous.
– Ah…
Labrousse eut un regard vers le hall où la femme patientait, statufiée sur des talons aiguilles qui l’obligeaient à une cambrure de reins outrageante. Il avait toujours détesté ce genre de gars, Malko Linge & Cie, munis de leurs exaspérantes facilités… Comment un auteur pouvait-il créer un personnage aussi pitoyablement fat que cet espion autrichien, et passionner des centaines de millions de lecteurs ? Au moins, lui, Labrousse, ne revendiquait rien d’autre qu’une forme de normalité.
L’autre s’inclina pour glisser sur un ton confident :
– Oui. S’il vous plaît Monsieur Labrousse, je m’intéresse beaucoup à votre auteur, ce Houellebecq. Fantastique ! 42 citations de marque en 345 pages. De ce point de vue-là, Sérotonine c’est énorme ! Et voyez-vous, ce que je trouve absolument fascinant c’est que cela est passé comme une lettre à la poste. De mon temps on aurait crié au scandale. Alors pourriez-vous lui transmettre ma carte ? Simplement au cas où il envisagerait de segmenter… C’est si facile. Tous deux avons chacun notre place, non ? Moi, sous sa plume je reprendrais bien du service. – Il se rapprocha encore et ajouta : pour tout vous avouer Monsieur Labrousse, les temps deviennent difficiles. Mon château coûte une fortune. Alors maintenant que la dite littérature a cessé de faire sa diva…
Labrousse acquiesça et glissa la carte sous son verre. Linge s’éloignait déjà. Il se retourna sur le seuil, lui adressant ce genre de clin d’œil complice mâtiné de désinvolture étudiée. « Connard ! » grinça Labrousse en lampant son reste de whisky. Puis il téléphona :
– Michel, salut…
– Quoi encore ? Je t’avertis, si c’est pour me bassiner avec tes états d’âme d’homme sandwich…
– Ecoute, tu ne devineras jamais qui est venu me draguer ?
– Franchement je m’en fous un peu. Partant de là où je t’ai laissé, ça ne peut être qu’une embellie. Et tu m’appelles pour ça ?
– Linge, Malko… Oui LE Malko, celui de SAS. À la rue le garçon ! Plus un flesh. Il veut bosser pour toi.
– Ah, tiens… Intéressant. Tu as son contact ?
– J’ai ça oui… Eh Michel, tu ne me lâches pas hein ?
– Mais non, mais non… Enfin, Florent, pour qui me prends-tu ?
Laurent LD Bonnet
-
L'éthique de la papaye - Nouvelle d'actualité ( parue sur Media part et Actualitté)
- Le 04/04/2020
- Dans Réflexion critique
L’éthique de la papaye.
Nouvelle d’actualitéJe ne sais à quoi peut servir un auteur par temps de guerre. Mais ce dont je suis certain, c’est qu’il peut, par exemple, se sentir légitime à « l’ouvrir », si dans son parcours, un « quelque chose de ses rencontres », l’expérience « d’un ou une autre » dans un « ailleurs et autrement », peuvent être versées à la compréhension, à la progression commune des choses. Il y a quelques jours, dans une réflexion sur « l’Après », je posais des questions, parce que je ne savais rien faire d’autre qu’interroger le réel. Aujourd’hui, je raconte une des réalités qui servit, bien qu’elle ne soit pas relatée dans le roman, à l’écriture de Salone. La métaphore et le symbole sont un des axes forts de la fiction. Ils nous permettent de sortir du cadre et d’observer notre réalité sous un autre angle. Cette histoire est donc, comme on dit, « fondée sur des faits réels ». Elle peut apporter un éclairage parmi d’autres, au tragique débat qui fracture, en France, plus que jamais le milieu médical et le milieu politique ; et qui, en réalité, s’avère un conflit éthique. (Le Quotidien du médecin du 02/04/20) Je l’ai écrite parce qu’elle illustre les raisons d’agir des hommes et femmes de médecine. Elle n'expose pas d'« avoir raison » ou d' « avoir tort » dans cette affaire, seulement les contraintes d'un choix éthique. N'est ce pas là le principal ?
Le contexte : Sierra Leone 1999. Le pays a été ravagé par une guerre importée du Libéria. Elle ne fut ni civile ni tribale, elle fut autre : complexe. On voulut croire que Salone racontait une histoire africaine ou une histoire de guerre, il fallait classer l’objet. Mais il n’en était rien. Salone raconte l’histoire du délitement d’une société, celle d’une nation structurée et d’une élite dépassée par les évènements.
À cette époque, les rebelles envahirent Freetown, puis en furent chassés. On coupa des mains par milliers. La population fut terrorisée. Sur place, les ONG répartissaient comme elles pouvaient leurs ressources, dans des hôpitaux de campagne ou des hôtels désaffectés. L’un d’entre eux fut un temps transformé en centre de réhabilitation pour enfants-soldats. Bien sûr, on y soigna aussi des villageois en fuite, des femmes violées au fil des routes, des enfants mutilés… On soigna. Ce fut-là, une première injonction : infirmiers, médecins, aides-soignants se plièrent à cet impératif : soigner, soigner, soigner. Une des urgences les plus courantes consistait à intervenir sur des plaies ulcéreuses et nécrosées. Certains arrivaient avec sur leur jambe des vers qui mangeaient la chair de la blessure, parce que c’était aussi un soin. L’autorité médicale de chaque district, en Sierra Leone, était représentée par un « Dispenser ».
L’histoire
À quelques miles de Freetown, un homme de 28 ans occupait ce poste ; nous l’appellerons Julius. Il n’était pas médecin, mais son grade de Dispenser nécessitait de suivre un sérieux cursus d'études médicales en Angleterre. Dans sa corporation, certains parmi les plus âgés, avaient laissé s’émousser l’arrogance de leur jeunesse : soigner en brousse érode les plus solides certitudes académiques. Lui, Julius, revenu d’Angleterre un an plus tôt, acceptait l’enfer qui régnait sur son pays comme une épreuve, la menant avec toute la rectitude et le professionnalisme qu’il savait mobiliser. Il avait été formé pour ça. Il connaissait les protocoles et les appliquait. Courageux, dévoué, apprécié, il menait sa barque.
Un jour, les antibiotiques, les pansements, les désinfectants vinrent à se raréfier puis à manquer. On en recevait encore, mais de manière sporadique. Alors on espaça les soins. Les surinfections se multiplièrent. On mourut. Plus. Beaucoup plus. Julius se démenait jour et nuit pour répartir la charge de travail de ses soignants ; il affrontait les barrages militaires pour transporter vingt pauvres pansements ici, là trente comprimés d’antibiotiques ; il risquait à chaque fois sa vie et s’épuisait. A cette époque, en Sierra Leone, on se déplaçait comme on pouvait, l’essence était rare, les embuscades probables, les abus de militaires eux-mêmes étaient à craindre.
Le médecin d’une ONG anglaise — nous l’appellerons Mike Briddle —, en route vers Freetown pour rejoindre le compoud de la Croix rouge, fut refoulé à un barrage militaire, fit demi-tour et vint demander à être hébergé dans l’ancien hôtel dont Julius avait fait son quartier général. On était en milieu d’après-midi, en mai. Les premiers signes de la saison des pluies apparaissaient, de lourdes nuées rampaient sur les collines et la mer. Julius reçut l’homme entre deux soins, devant la porte d’entrée d’un vaste bungalow.
— Mike Briddle, c’est ça ? LE Mike Briddle ?
Julius observait à la dérobée la dégaine du vieux bonhomme ; il acquiesçait tranquillement en hochant de la tête.
— On vient de me dire que vous demandez à dormir ici.
— Juste cette nuit. Demain ce sera une autre équipe au barrage, j’essaierai de passer à nouveau.
Julius se donna le temps de réfléchir en s’essuyant les mains sur un chiffon taché de longues trainées brunes. « C’était ça le vieux Briddle ? pensait-il, bah ! Après tout, ça me fera de la compagnie ce soir, on pourra discuter. Il doit en avoir des choses à raconter ce gars-là ».
— D’accord, je vous filerai le hamac sur la terrasse. C’est tout ce que j’ai.
— Ça ira très bien, je vous remercie.
— Je vous laisse y aller, j’ai du travail, répondit Julius en s’apprêtant à disparaitre à l’intérieur.
— Attendez !
— Oui ?
— Un coup de main ? J’ai du temps.
Julius hésita : de l’aide pensait-il, bien sûr oui. Mais laquelle ? Briddle ou pas, ce gars aux cheveux gras, campé là dans sa tenue de brousse, semblait sorti tout droit d’un mauvais film d’aventures ; de plus, les médecins anglais, ils les avaient fréquentés ! Eux et leur condescendance pour le p’tit gars qui débarque de l’ex-colonie pour se former.
— D’accord, mais je vous avertis, ce lieu est sous ma responsabilité.
— Pas de problème, bien sûr…
Il ne fallut à Mike que quelques secondes pour comprendre : l’odeur d’abord, puis les pansements trop sales, les visages fiévreux ; il y avait là dans la pénombre, une dizaine d’hommes assez âgés, allongés sur des bouts de matelas ou des tas de tissus mal rassemblés.
Julius murmura :
— On fait avec les moyens du bord. Il ne reste presque plus rien, vous comprenez ?
— Oui, oui bien sûr…
— Voilà, celui-là, dit-il en désignant l’homme allongé près de la porte, le pansement sur sa cuisse est à refaire ! Les produits et les compresses sont là-bas sur la table. Faites attention ! Il en reste très peu.
— Elle date d’au moins trois jours, commenta Mike qui s’était approché du malade et inspectait la compresse sale.
— C’est ce que je vous dis ! On n’a pas le choix. Plus rien n’arrive depuis une semaine. Bon ! je vous laisse, je passe dans le bungalow à côté. Retrouvez-moi là-bas quand vous aurez terminé. Merci !
Ils travaillèrent en fait chacun de leur côté, par souci d’efficacité, puis se rejoignirent à la nuit tombée, sur la terrasse du bungalow qu’occupait Julius, un peu à l’écart des autres bâtiments. Peu à manger : un reste de corned-beef, des galettes de manioc, une bière chaude, tout ça réuni sous la lueur d’une bougie fixée au milieu d’un cul-de-bouteille en plastique. Ils parlèrent de la guerre et du passé de Mike. Ça se faisait par bribes de souvenirs, à coups d’évocations douloureuses, parfois drôles, comme celles de ce gars, nu comme un vers, qui au petit matin la semaine passée, du côté de Bo, avait surgi du bush en criant qu’une bande de kamajors[1] lui avait tout pris. Bien sûr il n’aurait pas fallu en rire, mais c’était venu comme ça, et c’était bon de lâcher un peu de joie dans l’air.
« Bon, faut que j’aille dormir, maintenant », dit Julius en ramassant la boite de conserve et les fourchettes.
— Julius, juste une minute ! Je voudrais vous dire quelque chose.
L’autre hésita ; et sur un ton las :
— Quoi ? — puis il se rassit — allez-y, je vous écoute. Pas trop long s’il vous plait, ajouta-t-il en soupirant, comme déjà affecté d’avoir à argumenter, s’expliquer, peut-être se justifier.
Mike se racla la gorge. Il avait plusieurs fois affronté ce genre de situation : guerre des Mau Mau au Kenya, celle « du bush » en Rhodésie et d’autres, d’ex-colonie en ex-colonie ; ses quarante années de médecine en milieu tropical lui avaient asséché l’âme ; mais elles avaient renforcé aussi sa maîtrise du métier, l’avaient étayé de ce genre de pragmatisme rude, sans compromis, qui s’impose quand tout vient à manquer. Mike Briddle était connu de toutes les ONG. Pas un secrétaire, à Londres, n’oubliait avant de proposer une mission à quelqu’un de plus jeune, de s’enquérir de la dispo « du vieux ». Briddle était le Joker des missions difficiles. On disait de lui qu’il pouvait même, sans antibiotiques, sauver une jambe de la gangrène.
Julius attendait. Il avait entendu parler de tout ça. Bien sûr, c’était des légendes. Il avait vu Briddle travailler tout l’après-midi : concentré, calme, il avait fait le job ! Bien. Comme tout le monde. Et ça n’avait rien de miraculeux.
Julius, je pars demain, alors ce que je vais vous dire, vous en ferez ce que vous voudrez. J’ai observé tous ces gars, ces femmes, leurs gamins… Vu l’état de leurs blessures, et le peu de produits qui restent, vous n’allez pas en sauver deux sur dix.
— Vous croyez que je l’ignore ?
— Attendez ! Laissez-moi vous expliquer, j’ai connu ce genre de situation. Et vous avez une chance de vous en sortir. C’est une méthode que j’ai utilisée, elle fonctionne, mais ça n’a rien d’officiel…
— C’est-à-dire ?
— Derrière vous ! Mike désignait un plateau où étaient déposés trois gros fruits verts un peu oblongs. Julius se retourna brièvement.
— Quoi ? Ces papayes vous voulez dire ? Bah ! Mais qu’est-ce vous racontez !
— Julius, je vous assure que ça marche. Il faut appliquer le cataplasme avec la bonne méthode, mais ça marche !
— Mais ça va pas ! Même les Juju men ne m'ont jamais parlé de ça ! Bah ! ous kind bush mérécin nar this ! C’est quoi cette médecine de brousse ! (2)
Et il se leva brusquement pour disparaitre dans la cuisine où il s’affaira longuement à une vaisselle très sommaire. Lorsqu’il revint, Mike rangeait un stylo dans sa poche de chemisette et tendait un papier : « Tenez, je vous ai indiqué la procédure. Vous ferez ce que vous voulez. Moi je vous dis que ce fruit, surtout quand il est très mûr, libère une substance active qui nettoie les chairs infectées. Il faut compter trois à quatre jours. Vous ne disposez que d’une seule chance et c’est demain, parce que j’ai compté à peu près le nombre de compresses qui restent. Soit vous les économisez comme vous faites, c’est le bon protocole, et la plupart de ces gens vont mourir dans les dix jours. Soit vous épuisez le stock dont vous disposez en une seule fois, pour ce cataplasme à la papaye, sous cellophane, scotch, tout ce que vous trouverez d’étanche pour le protéger et qu’il tienne, et dans quatre jours tout est fini, vous en aurez sauvé les trois quarts ! Les autres, c’est qu’ils sont déjà trop atteints par l’infection. Voilà, Julius…
Julius accepta le papier en marmonnant un bref « Merci on verra », puis rejoignit sa chambre. Mike s’installa dans le hamac, rabattit la moustiquaire et s’endormit rapidement. Une heure plus tard, une brise descendit des monts et imprima à la toile un léger mouvement de bascule. Réveillé, Mike Briddle regardait le ciel. C’était sans doute sa dernière mission ; et il se demandait s’il aurait assez de place pour fixer son propre hamac sur la terrasse du deux-pièces à New Heaven. Un bruit attira son attention, il tourna la tête et aperçut un homme qui franchissait les deux marches du perron ; Julius s’avançait vers lui. Ils se mirent à parler à voix basse et Mike Briddle put saisir une bribe de phrase portée par le vent : « Bo duya you go manage find some popo them...rape -rape one » : débrouille-toi pour trouver rapidement plein de papayes bien mûres, et vite !
Laurent LD Bonnet – mars 2020.
www.laurentbonnet.eu[1] Bandes de chasseurs réorganisés en milices.
2 Langue krio
Conflit éthique : Le Quotidien du médecin 02/04/20
-
Grippe et Paix 1969-2020 - Réflexions sur l'après guerre.
- Le 22/03/2020
- Dans Réflexion critique
Cette photo…
Cette république avait onze ans, New York remplaçait Paris,
Déjà sous cette Cinquième, naissaient de possibles marquis,
Et de futurs présidents, chez qui, par maint endroit,
Le front de monarque briserait le masque étroit.[1]Tolstoï, Hugo, pairs et génies des lettres, s’il vous plait, ne m’en voulez pas de ces emprunts détournés, je n’ai su me retenir.
Cette photo …
68 s’achevait. Nous, gamins, avions failli être gavroches. De Gaulle, qui n’avait guère besoin d’anaphores pour s’affirmer chef de guerre, acceptait son déclin. La guerre, de vingt-cinq ans notre ainée, trainait partout en famille ; on entendait au moment de rompre le pain : « Encore un que les boches n’auront pas ». Les morts rôdaient encore. Nous le savions. Mais la paix grandissait, déjà drapée de sa normalité.
Puis venant d’Asie, passée par les USA, précisément l’hiver 69 où fut prise cette photo, une grippe s’installa en France. Plus de 31000 morts en deux mois ! Or je me souviens des barricades, des discussions enfiévrées, des livres et des photos sur Buchenwald, de films de toutes sortes, et d’Apollo, de la lune et des étoiles, du Vietnam, des bombes là-bas et du napalm, de deux mots répétés sans cesse à la radio : « marché commun » et j’ai mis si longtemps à comprendre que sous la parure d’Europe, c’était bien sûr encore eux qui menaient la danse… Oui je me souviens de tout cela et de bien d’autres choses, avec lesquelles, nous, gamins, nous meublions notre mémoire. Mais des 31226 morts[2] en France et plus d’1 Million dans le monde, dus à cette « grippe de Hong-Kong » : RIEN ! Aucune trace, aucun souvenir. Elle est passée ainsi la grande faucheuse, sans remuer plus que ça l’opinion, les pouvoirs publics, la presse… qu’on ne qualifiait pas encore de média. Libération raconte :
« Que l'«épidémie» frappe urbi et orbi l'humble et le puissant, voilà d'ailleurs qui déchaîne l'humour plus que l'émoi. Le 31 décembre 1969, pour le réveillon, le Monde offre un billet badin décrivant, en direct de Londres, le délicieux chaos qui grippe la perfide Albion (plus durement touchée que la France) : les hôpitaux de la capitale devenus le «dernier salon où l'on cause» puisqu'on y rencontre artistes et célébrités politiques, celui de Birmingham «qui embauche n'importe qui» afin de faire face à la défection de «500 infirmières», les queues devant les pharmacies pour les livraisons d'aspirine, les pannes d'électricité faute de techniciens, les lignes de métro interrompues faute de conducteurs... En janvier, Paris Match n'envoie pas ses paparazzi dans les urgences saturées, mais dans l'alcôve Louis XVI où s'alanguit Marina Vlady : «Non, titre l'hebdo, Marina n'a pas la grippe de Hongkong, elle tourne son nouveau film.» La grippe, dont nul ne signale les morts, est alors moins qu'un fait divers. C'est un «marronnier d'hiver», écrit France-Soir... ( Par Corinne Bensimon — 7 décembre 2005) »[3]
Que dit de nous cette amnésie ?
Elle interroge notre rapport à la mort bien sûr. Soixante années de paix, de progrès scientifiques l’ont totalement et profondément modifié.
Elle interroge l’aune dont nous usons pour jauger de la gravité. Et sur cette photo, l’insouciance se lit dans beaucoup de regards. Je ne suis pas certain que la même puisse être prise aujourd’hui, à supposer que l’on puisse encore capter les regards. On y lirait sans doute, l'écho démultiplié des anxiétés en réseau, l'accélération fébrile des injonctions...
Elle questionne la dépossession progressive du pouvoir citoyen que consacra l’avènement de cette cinquième république ; et que nous, gamins de cette photo, allions confirmer huit ans plus tard en accédant à notre droit de vote, mais sans réfléchir plus que cela, tant nous semblerait confortable l’idée qu’on ait pu concevoir pour un rôle citoyen, une telle aubaine : pensez-vous ! Quelques jours de travail par an, parfois aucun, et des milliers d’autres disponibles pour jouir, travailler et capitaliser sans entrave : « On s’occupe de tout, citoyens, revenez dans sept ans ! »
Le réveil est glacial.
Elle percute de plein fouet nos certitudes : l’Etat Français tel qu’affadi par un demi-siècle — moins quelques années des lumières — d’assujettissement grandissant aux principes marchands, est encore beaucoup plus faible que « nous » (c’est-à-dire celles et ceux qui déjà ne rêvaient plus) l’avions estimé.
Cette photo…
Elle m’interroge : 25 ans de paix derrière elle et 40 autres à la suite … Des dizaines d’élections, rarement je me suis abstenu. À quoi bon ? Puisqu’au bout du compte — car il s’agit bien de cela : un compte dans le conte, un compte que nous avons à rendre à nos consciences. Et que les pitres incompétents — ceux d’avant et d’aujourd’hui que « nous », votants et abstentionnistes confondus dans une collusion perverse, mais réelle, avons tous portés au pouvoir —, auront à rendre demain, pour avoir fait d’Excel leur Dieu, et de ses formules une alchimie qui aujourd’hui nous asservit, pendant que « nous », les jouisseurs, la vénérions pour qu’elle fasse de nous des enrichis.
Cette photo oui : douze ans après elle, mon vote et ceux d’autres dans cette salle de classe, porteront la gauche au pouvoir. Un des gamins, là, fils d’ouvrier, est devenu maire d’une grosse ville de province. Nous étions amis. Et puis sur cette photo aussi, certains voteront à droite. Et je me demande : une autre histoire politique aurait-elle mené au même tragique fiasco d’aujourd’hui ? J’ai envie de dire oui, de ne plus croire à l’idée que le pouvoir est encore — un peu quand même — entre les mains du citoyen. Mais pourquoi le serait-il ? Puisque nous en avons abandonné la maîtrise en nous laissant refourguer cette foutue et confortable idée de délégation sans contrôle !
Et donc sur cette photo encore, combien parmi ceux qui vivront en 2022 (les statistiques proposent 80% en ce temps dit de paix) feront encore semblant de croire, de participer, par leur ignorance, leur déni ou leur adhésion, à la soupe messianique qui nous sera servie ?
En réalité, cette photo ne me donne plus qu’une envie : lever la main et poser une question à l’instituteur debout à côté du photographe. De lui je me souviens !
Deux choses précisément : d’abord il montait à la corde ; celle-ci, accrochée au centre de la trémie d’un vaste escalier, s’ouvrait jusqu’au toit, sept mètres au bas mot. Et cet homme, au début de chaque cours de sport, commençait par s’asseoir à terre et montait à mains nues, jambes à l’équerre, jusqu’au sommet. Rien à voir ? Pas si simple. Car pour nous, gamins, c’était un exploit. Certes physique, mais il nous menait à une forme de respect. Et sa parole, en salle, devenait d’or ou d’airain, selon nos besoins. Alors j’en viens au second souvenir : cet homme qui sans doute avait connu la guerre, l’avait faite, l’avait perdue puis l’avait gagnée (j’appris plus tard son action en Résistance), nous assénait une phrase à chaque leçon d’histoire, toujours la même, et je ne suis pas certain de l’avoir si bien comprise à l’époque. Pourtant elle m’est restée, et ce dont je suis certain à présent c’est de l’avoir intimement et définitivement acceptée, ce 16 mars 2020, quand Emmanuel le petit, se fendit de son anaphore guerrière pitoyablement nécessaire. Parce que l’instituteur nous répétait, et je le cite : « Quand on fait la guerre, c’est qu’on a perdu la paix. » D’autres l’ont dit, ailleurs et mieux sans doute, mais lui, c’est dans la tête des gamins de cette photo qu’il inscrivit cette phrase.
Elle m’amène aujourd’hui à une conclusion : cette paix, celles et ceux que nous avons portés au pouvoir depuis un demi-siècle, l’ont perdue. Nous l’avons perdue avec eux. Cela s’analyse, se décrypte, s’explique. Et l’évidence qui s’impose à nous, sauf déni et aveuglement, c’est qu’un monde fondé sur des prémices industrielles et marchandes est une impasse. Ce n’est même plus la peine d’en discuter, c’est, de fait, une, impasse !
Le seul préalable acceptable de toute future organisation, ne peut plus être que l’affirmation de la préservation des biens communs essentiels à la vie : notre air, notre eau, notre environnement. Cela doit fonder les bases d’une nouvelle constitution, un nouveau corpus de valeurs, de nouvelles lois, une nouvelle organisation politique, au sein desquels nous, et nos enfants et les enfants de nos enfants, pourront respirer. C’est là, je crois, le seul programme politique auquel on devra apporter crédit en 2022 : la refonte immédiate de notre organisation citoyenne. Reprendre le pouvoir quotidien est notre seule alternative. Tout autre programme qui s’appuiera sur un catalogue d’intention ou de promesses ne sera que soumission à un énième rhéteur, expert en manipulation des émotions[4].
Non, vraiment, le seul discours audible, le seul engagement crédible sera : « Je n’ai qu’un unique programme, l’imagination, la vôtre, pour participer à la rédaction et à la mise en œuvre d’une nouvelle constitution. Rien d’autre. Désolé. Je vous demande juste de m’élire pour que je puisse vous redonner les clés de la maison. »
Oui, je sais, j’écris des fictions, on dira que je rêve. Tout cela n’est qu’hypothèse de romancier. Restez dans la photo !
Bien, j’y retourne alors… Mais je lève la main, quarante années plus tard, et je la pose cette question : « M’sieur, M’sieur ! On a compris. On n’a plus envie de jouer. Comment on fait pour sortir du conte ? »
[1] « Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte.
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte,
Et du Premier Consul déjà par maint endroit
Le front de l’empereur brisait le masque étroit. »1728
Victor HUGO (1802-1885), Les Feuilles d’automne (1831)[2] Unité 707 de l'Inserm-Université Pierre-et-Marie-Curie, à Paris.
[3] https://www.liberation.fr/france/2005/12/07/1968-la-planete-grippee_540957
[4] Le Gorgias de Platon : Dialogue sur la rhétorique
-
Au cœur de cette lenteur se trouve le secret : changer le rapport au temps. (réflexion critique).
- Le 08/01/2020
- Dans Réflexion critique
Article instructif dans le Monde sur l'état du marché du livre. On nous alerte ; le Club des Cinq et Monte cristo sont en grand danger. Une envie de commenter, donc.
EXTRAITS, tout d'abord :
Olivier Nora ( Grasset ) En deux mois de rentrée, la profession a proposé ce qui correspond habituellement à un an de production : trente à quarante best-sellers. Cela n’a pas pu se faire sans dégâts. (.... ) D'un coté, de moins en moins de références qui se vendent de plus en plus et, de l’autre, de plus en plus de références qui se vendent de moins en moinsJean-Maurice de Montremy, à la tête d’Alma Editeur, rappelle que « quinze nouveautés permettent aux grands éditeurs d’occuper 1,5 mètre de linéaire sur la table d’un libraire…
Viviane Hamy, qui a fondé les éditions du même nom, déplore le fait qu’il soit devenu "effroyablement difficile de travailler dans la durée, d’imposer au fil du temps l’œuvre d’un écrivain".
La cristallisation sur les prix Goncourt, Goncourt des lycéens, Femina, Renaudot ou Médicis atteint un tel paroxysme qu’elle balaie toutes les autres nouveautés mises sur le marché en octobre.
« On a vu cette année des livres mort-nés », déplore Sabine Wespieser, à la tête de sa maison d’édition indépendante. L’entre-deux peine aussi. Certains romans qui s’écoulaient voici plusieurs années à 30 000 exemplaires ont du mal à atteindre la moitié. (.......) « Je peux continuer à ne produire que dix livres par an parce que j’ai trois salariés. Pour les groupes qui en emploient 300, c’est une fuite en avant. » En cas de retournement du marché, ils sont obligés de produire toujours davantage, pour éviter que l’arrêté des comptes des diffuseurs soit négatif. Les libraires retournent en effet les livres invendus aux éditeurs. « Personne ne peut plus décélérer », explique-t-elle.
« La concurrence s’exacerbe même dans le polar. Toutes les maisons d’édition s’y sont lancées et rivalisent de façon saignante. Les morts sur le champ de bataille n’ont jamais été si nombreux », affirme Laurent Laffont, directeur général de JC Lattès.
Nous étions dans un marché de l’offre, on arrive dans un marché de la demande », prédit Vincent Monadé, président du Centre national du livre. Comme aux Etats-Unis, où Amazon impose le succès par les algorithmes. En raison d’un système d’entonnoir, le public devient myope, ne distingue plus rien hormis les best-sellers et les livres primés. (....) La concurrence entre la lecture et les autres loisirs est indéniable. « Le livre, déjà en concurrence avec le théâtre, les concerts et la télévision, affronte aussi le jeu vidéo, les réseaux sociaux, les séries… alors que le temps consacré aux loisirs reste le même », commente encore Vincent Monadé. « Dans les dîners en ville, on parle davantage des séries que l’on a vues que des livres que l’on vient de lire », ajoute Laurent Laffont. La compétition s’envenime. « Force est de constater qu’un roman coûte le prix de deux mois d’abonnement à Netflix », dit Pierre Conte. L’arbitrage financier ne s’effectue plus forcément en faveur de la littérature
Claude de Saint-Vincent, directeur général de Média Participations. « Jadis, à 18 ans, on avait forcément lu Le Comte de Monte-Cristo. Aujourd’hui, les adolescents peuvent rester treize heures devant un écran à dévorer Le Bureau des légendes. »
Et pour les plus jeunes, « l’utilisation du passé simple dans Le Club des Cinq, d’Enid Blyton, a été supprimée et l’histoire encore simplifiée », constate-t-il, en se demandant s’il faut hurler de rire ou en pleurer…
COMMENTAIRES
Il est toujours intéressant, à défaut d'être rassurant ou gratifiant, de constater à quel point le ressenti du producteur de matière première — et l'analyse qu'il peut mener depuis sa mine à ciel ouvert, où trainent, a priori inutiles en ce domaine, les seuls outils de son intuition — corroborent en tous points les termes de cet article. C’est pourquoi, avant de retourner au chantier, j’ai envie d’exprimer tout d’abord un credo d’auteur : Tenir. Progresser. Et n'écrire que par besoin vital. Ensuite une attitude de lecteur : Chiner ! Aux deux sens du verbe . C’est-à-dire railler. Et flâner.
Enfin une intuition, puisqu’il s’agit de sauver le soldat Lecture : je crois qu’il faut l’équiper d’un matériel de survie, d'un " Facteur clé de succès" dont il dispose peu ou mal : le facteur temps. Là se trouve son défaut. Et sa chance !
Inutile de se plaindre ( Ah, mais un livre prends tant de temps ! ), ou de courir après la quantité, jeu qui ne mène qu'à accélérer au coeur d'une dimension fixe, éternellement fixe, de 24h... À ce jeu consistant sans cesse à "placer plus d'activités et de sensations" en une même durée, l'édition littéraire sera toujours perdante.
mais transformer un handicap en fierté : voici la gageure.
Oui, lire s'avère lent. Tout simplement lent. Or au cœur de cette lenteur se trouve le secret : changer le rapport au temps. Lire permet de distendre le temps, évite la soumission des cerveaux au principe de diffusion industrielle. Lire cultive l'art du retrait, de l'absence, du "face à soi-même". Lire pourrait devenir un argument de santé, d'équilibre. Il faut s'emparer de cette chance, la faire connaître : lire permet d'agrandir son temps intérieur.
Le soldat Lecture survivra, si on l’exfiltre du champ de bataille de la vitesse. D’urgence. Et si on l’installe dans un ailleurs. Serein. Posé. Modèle vital d’apaisement et de réflexion. En quelque sorte un enjeu de santé publique.Et sur le temps, l’envie de partager Borges :
…..le soupcon général et brumeux
de l’énigme du Temps ;
c’est l’étonnement que devant ce miracle
qu’en dépit d’infinis hasards,
et gouttes que nous sommes
du fleuve d’Héraclite,
quelque chose puisse durer en nous
immobilement. -
Homo commercialus ( reflexion)
- Le 06/01/2020
- Dans Réflexion critique
Cap Finisterre,
Ce soir là, je me suis demandé quels rapports, il y a 2000 ans, pouvaient bien entretenir les Artabres orpailleurs de ce Finisterre là avec les marchands Osismes de notre Finistere breton. Du commerce bien sûr, du commerce... déjà.
-
De la valeur littéraire et son appréciation. (réflexion)
- Le 06/01/2020
- Dans Réflexion critique
L'auteure d'Harry Potter publie un roman sous un pseudo : 1500 exemplaires vendus. Une fois révélée, elle vend le même roman à 500.000.
Que dit ce constat de la valeur littéraire et son aprréciation ? De nos désirs concertés ? Du récit de la qualité et des fables de la quantité ?
Je ne peux trouver réponse mieux exprimée que par Borges :
"Borges n'ignora pas l'histoire, mais la seule histoire littéraire qu'il reconnaissait était celle de la lecture. Ce sont les lectures qui sont historiques, et non pas les œuvres, dans la mesure où celles-ci restent toujours les mêmes et seules les lectures changent avec le temps. La valeur même des œuvres en dépend.(1)"
Ainsi, dans un essai de 1928, c’est un Borges universel et visionnaire qui nous propose, à travers l’exemple de la métaphore, de bien vouloir considérer les événements de nos entrepreneurs en littérature, comme ce qu’ils sont, et non comme ce qu’ils prétendent être. La qualité littéraire ne se décrète pas sur un calendrier. Elle s’inscrit, se grave, et nous interpelle, vraiment, à force de temps et d’espace. Un temps long. Un espace circonspect. Notions certes aujourd’hui entachées de désuétude. Sauf à bien lire et écouter Borges :
" Si les manifestations de beauté verbale que peut nous accorder l’art étaient infaillibles, il existerait des anthologies non chronologiques, voire dépourvues de listes d’auteur. La seule évidence de beauté de chaque composition suffirait à la justifier. Cette conduite serait bien évidemment extravagante et même dangereuse dans les anthologies en usage. Comment admirer les sonnets de Joan Buscan, si nous ne savons pas qu’ils furent les premiers à être écrits dans notre langue ? Comment supporter ceux d’Untel ou d’Untel, si nous ignorons que ces derniers en ont commis beaucoup d’autres, encore plus intimement désastreux, et qu’ils sont de surcroit, amis de l’anthologiste ? Je crains, sur ce point, de ne pas être très clair et au risque de trop simplifier le sujet, je vais donner en exemple la métaphore suivante, isolée de son contexte : « L’incendie, avec ses féroces mâchoires, dévore les champs. »
Cette locution est-elle condamnable ou bien acceptable ? J’affirme que cela dépend uniquement de la « qualité » de son auteur, et cela n’est point un paradoxe. Supposons que nous soyons dans un café de la rue Corrientes et qu’un auteur me la propose, comme étant sa dernière trouvaille. Je penserai : « Faire des métaphores est aujourd’hui, une préoccupation très commune. Remplacer « dévorer » par « brûler » ne serait pas un changement très avantageux ; l’allusion aux mandibules en étonnera plus d’un, mais c’est une faiblesse du poète qui se laisse entrainer par la locution « feu dévorant ». C’est un automatisme. Bref, tout cela est nul … » Supposons maintenant qu’on me présente cette phrase comme venant d’un poète chinois. Je penserai : « Pour les chinois, tout se rapporte au dragon, et je me représenterai un incendie lumineux comme un feu de joie, tournoyant dans un mouvement perpétuel, et cela me remplira de satisfaction. Supposons que la phrase soit utilisée par le témoin d’un incendie ou mieux encore, par une personne menacée par les flammes. Je penserai : « Cette conception d’un feu avec des mandibules est véritablement horrible et cauchemardesque et elle ajoute une odieuse malignité humaine à un fait inconscient. La phrase dès lors est presque mythologique et pleine de vigueur.» Supposons que l’artisan de cette représentation allégorique soit Eschyle et qu’il la mette dans la bouche Prométhée (et telle est la vérité) et que le titan enchainé à un rocher escarpé, par la Force et la Violence, cruels ministres, la clame à l’océan, vieillard chenu, venu prendre part à son infortune, en voiture ailée ; dans ces conditions la sentence me semblera très heureuse et même parfaite, étant donné le caractère extravagant des interlocuteurs, et l’éloignement désormais poétique de son origine. Je ferai comme le lecteur qui a sans doute suspendu son jugement, en attendant de bien vérifier qui était l’auteur de la phrase. Je parle sans la moindre ironie. La distance et l’antiquité qui sont la forme emphatique de l’espace et du temps, gagnent notre cœur.
Et Borges de conclure un peu plus loin , — après avoir poussé jusqu’à Cervantes et Walt Whitman la réflexion sur les territoires mentaux de la littérature — :
« C’est dire que les grands vers de l’humanité n’ont pas été écrits et c’est de cette imperfection que doit se réjouir notre espérance."(1° Perrone-Moisès Leyla. L'histoire littéraire selon J.-L. Borges. In: Littérature, n°124, 2001. Histoires littéraires.
-
Admiral Fitzroy (réflexion)
- Le 06/01/2020
- Dans Réflexion critique
Enchassé dans le granit de Galice depuis 1868, l'admiral Fitzroy Barometer défie le temps, les téléchargements et les modèles numériques
Tranquille et sage, il conseille : media lluvia media borrasca : Reste au port, voyageur de la mer.
Ce Fitzroy-là commanda l'expédition du Beagle sur lequel embarqua Darwin. -
De l'inspiration (réflexion)
- Le 06/01/2020
- Dans Réflexion critique
Beaucoup s'étonnent que l'on puisse s'aventurer au large : L'immensité, l'isolement, l'impossible démission, le sentiment de colères liquides impossibles à mesurer, à qualifier. Je peine parfois à expliquer.
Découvrant cette photographie, je réalisai que la réponse se trouvait là : Côtoiement respectueux avec l'immensité, l'isolement, et les colères liquides que l'on apprivoise en leur caressant l'échine. Écrire un roman ressemble à cela.
Baie de Sydney - © Haig Gilchrist -
Des choix en écriture ( réflexion)
- Le 06/01/2020
- Dans Réflexion critique
Existe en écriture, un point précis du temps à partir duquel tout bascule : choix de l’angle… du point de vue, champ ou du contre champ, en somme nous décidons du destin de l’inspiration.Au-delà de cet instant, tout diffère. On suggérera un état d’ordre quantique… L’autre celui dans lequel on n’écrira plus, diverge, s’éloigne et disparait. Il ne sera plus, après 10.000 puis 100.0000 mots agencés dans l’architecture choisie, qu’une vague ombre du passé.
Et nous progressons sur un chemin de poussières. Empreints de tendresse pour le roman qui nous accompagne et dont on est certain qu’il est seul désormais, à pouvoir aboutir. Au commencement pourtant, comme à partir de cette photo, était l’angle. Puis il fallut régler sa longueur d'onde
Choix mystérieux à multiples inconnues. Sans retour.
Ici quelques exemples d'angles et variations de longueurs d'onde.
Cette dernière, encore plus complexe à régler, serait dans cette métaphore de la patte d'oie, le choix de monture.
Sommes nous arbitre de ces choix ? En apparence seulement, car derrière l'auteur existe une magie, l'histoire, les histoires. Chacune d'elle requerra son angle et sa longueur d'onde. Et je préfèrerai toujours ouvrir la porte, m'effacer, pour offrir le passage à l'éternelle formule qui rassemble tous les choix : Il était une fois.
.................................................................................................
De toute façon cette foutue bécane avait fait son temps. L’abandonner ici ou ailleurs ne changerait rien à l’affaire. La balancer dans le fossé non plus, il valait mieux la laisser visible. Elle ferait sans doute le bonheur d’un ferrailleur du coin, ou d’un gamin bricoleur qui la retaperait en rêvant à son premier grand voyage…
……………………………………. ou
Mailee marchait sur cette piste secondaire depuis une dizaine de miles. La carte indiquait un croisement avec Ellis Rd où elle pensait tendre le pouce, rejoindre la 83 pour Eden et trouver une dépanneuse. De toute façon, le motard qui s’était arrêté une demi-heure avant et lui avait promis de prévenir le premier garage, ne lui serait plus d’aucun secours… Sa moto gisait là au milieu de la route, délestée de son paquetage. Mailee apercevait au loin en plein milieu du filet blanc de rocaille, la silhouette du bonhomme qui oscillait dans la chaleur.
…………………………………………………………………. ou
Douzième prise… Harper travaillait à l’ancienne. Il ajustait encore la mise au point, calculait l’ombre qui durcissait l’ambiance, modelait le jeté de bras de la fille et Bon Dieu ! Elle avait mis une heure à comprendre ça ! Comme la longueur de son pas qui réglait le déhanché, mais cela avait été plus facile, bien sûr ! Encore une fois Pitt s’était foutu de sa demande : « Sur ce coup, tu vas me dégoter une danseuse ! Pas un de tes modèles qui ne savent jamais quoi faire du haut de leur corps.» Pourtant celle-ci se débrouillait bien, une vraie bosseuse. « Allez vas-y ! s’écria-t-il, et retourne-toi juste après être passée. Curieuse ! Tu entends ce que je te dis ? Tu es curieuse ! » La fille acquiesça et se mit à marcher vers Harper. Il pensa : « J’adorerai toujours cet instant, juste celui-ci...»
………………………………………………… ou
C’est vrai, j’avais fini par détester Fred, Ô Dieu c’est vrai, mais pas au point de lui souhaiter du mal, encore moins de le tuer. Et pourtant… Je crois bien que cette idée-là m’est venue au petit matin, entre le premier bruit de roues sur le bitume, et sa première toux crachoteuse qu’il a collé avec son odeur dans mon dos ; j’ai senti son souffle qu’il essayait de glisser vers mes hanches, et je me suis dit : « Maintenant qu’il a viré la tune, il faut que ça cesse… » Et voilà que sa sale carcasse d’obsédé bouffait la poussière du canyon, cinquante mètres en dessous du rocher où nous avions piqueniqué la veille. Après cette difficile minute, tout devint simple : J’étais pour un temps — celui indispensable à ma résurrection — la fille qui signalait une moto abandonnée. Au-delà, je serais loin…
…………………………….. ou
Il y a des soirs comme ça. Tout va mal. Vraiment tout. Du taff définitivement sans perspective, jusqu’à la belle-mère qui vous harcèle de coups de fil pour savoir où est passé « son » Charles, avec une étape par votre meilleure amie qui vous reproche l’absence de réponse à son courriel de la veille, une autre par « votre p’tit garagiste » qui vous annonce une réparation pour laquelle rien qu’en main d’œuvre, « il faut bien compter 900 euros », enfin une dernière, l’apogée du désastre bien sûr, «votre p’tit cordonnier » fermé pour cause exceptionnelle à 18h, avec là-bas sur son comptoir, posé en évidence, une enveloppe avec un nom écrit en gros, Rachel Gontz, Vous, avec les deux mains accrochées à la grille, en train de crier « Merde » dans votre écharpe parce qu’il fait très très froid et que dans cette enveloppe se trouvent la clef de votre appartement et son double... Alors vous marchez dans la ville qui s’assombrit. Des gens fument sur un trottoir en buvant un verre. On vous regarde sans trop vous prêter d’attention et vous décidez d’entrer dans cette salle qui de l’extérieur ne ressemble pas à grand-chose, en tout cas pas à un bar. Vous lisez sur une vitre : Exposition Marc Volunteer. Le nom bien sûr vous amuse. Et vous avancez jusqu’aux premières cimaises que vous apercevez au-dessus des têtes. On s’écarte. Vous vous faufilez, et ça devient… mon histoire :
A/ Quand j’ai vu cette route qui s'étirait depuis nulle part, cette fille seule, avec sa moto peut-être, je fus envahie de ce genre de petite évidence qui gagne et s'insinue : Cette fille c'est moi.
B/ Quand j’ai vu cette route qui ne ressemblait à rien de connu, cette bécane abandonnée comme un cadavre et cette fille seule qui s'en foutait je n'eus plus qu'une obsession : la retrouver, elle, cette fille et son indifférence magnifique ; ça me plaisait et je voulais en connaitre le secret.
C/ Quand j'ai vu cette route, la dimension graphique de cette moto qui semblait bramer la gueule ouverte pour que cette fille l'achève plutôt que l'abandonner à une mort lente, je fus gagnée par une insidieuse obsession qu'il fallut bien m'avouer le soir-même à l'hôtel : Je voulais rencontrer ce photographe.
................................................................................................ et
Il manquera les points de vue de la moto, de la route, du crotale qui serpente dans la rocaille, du shériff ou d’un fermier qui arrivent en pick-up et aperçoivent cette scène, et puis d’autres angles encore, d'autres longueur d'onde, une infinité sans doute… ceux-ci n'appartiennent qu'à une journée, un état.
Une seule inspiration survivra. Pour l'histoire. Et son sens.
-
De l'usage étymologique en voyage
- Le 28/12/2019
- Dans Réflexion critique
Escale : échelle facilitant le débarquement ou l’embarquement.
Débarquer : être dans l’état de celui qui descend de sa barque ; ignorant des faits récents.
C’est vrai, rien ne définit mieux l’acte de traverser : ni rail ni bitume, ces liens incessants… Pas de ciel où nous nous projetons en d’avides accélérations. Oui… l’eau demeure, par son danger, ses parures, son lyrisme et les faciles emphases qu’elle suggère, cet amer et long chemin dont le joug à chaque fois nous oblige à renaitre ignorants. Et sans doute est-ce pour cela qu’à chaque escale ils me sautent aux yeux, ces "Impossibles à ignorer" :
Melinda, la pompiste de la station maritime de Cariacou… Elle voulait embarquer mais n’avait pas le temps de trouver son échelle…
Sekie, l’homme du beach bar à Chatham… Il tremble chaque année à l’idée qu’un groupe d’industrie touristique accepte l’offre du gouvernement : 40 millions de dollars pour développer un projet sur la baie.
Adonis Small, l’homme de Châteaubelair à St Vincent. Il m’aborde en barque à rames, préfèrera trois bières à un repas, et montrera, fier, ses mains de « sugar can workers ». Do you think I can work in Guadeloupe ? — Ey Adonis, you know… owners of sugar can fields are descendant of slavers… How do you think they consider black workers ? Ey Adonis, you know… How do you think they consider sugar can workers ? — Yes man, but 100 € for a day… (1)
Comment ignorer les paquebots dévoreurs de paradis lorsqu'à quelques milles se courbe pour survivre dans la rocaille volcanique ce jardinier d’un Eden insensé ?
Et nourris des mêmes ciments ravagés, fleurissent en frères d’armes, les grafs des gangs : CRIP, NDM... (2)(1) Tu crois que je peux travailler en Guadeloupe ? - Ey Adonis, tu sais, les propriétaires de champs de canne à sucre sont des descendants d'esclavagistes... Comment penses-tu qu'ils considèrent les travailleurs noirs ? - Oui mec, mais 100 € par jour.....
(2) Crips : Gang afro-américain créé à Los Angeles en 68 ; Les Crips se déclineront ensuite aux pays limitrophes sous influence américaine.
(3) NDM : New Democratic Party : pour en parler, Adonis Small baissait la voix et jetait sans cesse un oeil derrière son épaule... -
Des regards en voyage
- Le 28/12/2019
- Dans Réflexion critique
De cette première escale à Grenade, je retiendrai le vent, l'amitié, le large aux parfums Maltesiens, et sur l'île de Cariacou, ce regard de femme qui ne m'était pas adressé. Celui qui le reçut l'ignora. Alors j'ai imaginé ses molécules invisibles éparpillées dans le vent, errant à jamais. Où se trouve le cimetière des regards perdus ?
Enfin, ce 1er novembre à Greenville, en escale sur l'austère et inhospitalière côte Est : à qui, à quoi pensait ce vieil homme devant la turbulence du port et mon voilier au mouillage ? C'est son âge qui m'a d'abord répondu : génération Bishop ! ai-je imaginé. Maurice Bishop .. Fusillé quelques jours avant le débarquement américain de 83. Et lui, aujourd'hui, seul au premier étage d'un bâtiment délabré dont le fronton annonce Bakery mais où ne se trouve aucun pain, au souvenir de quelles blessures son corps se tordait-il ? Opposant, ? Compagnon de route ? Ou rien d'aussi politique … Je reviendrai me suis-je dit, il sera là et je lui parlerai.
Une semaine plus tard, triant mes clichés, je me renseignai : une partie de la Task Force débarqua ici dans la rade de Greenville, le 25 octobre. Les combats prirent fin le 1er novembre